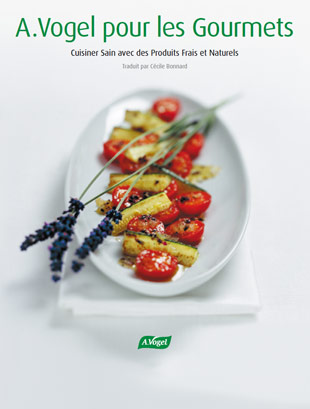A.Vogel recherche
Lorsque la recherche interne est activée, des données personnelles telles que votre adresse IP sont transmises à notre moteur de recherche Cludo. Les données sont ainsi transférées vers un pays tiers. Veuillez cliquer ici si vous souhaitez afficher la recherche interne. Vous trouverez plus d'informations sur la protection des données ici : Protection des données.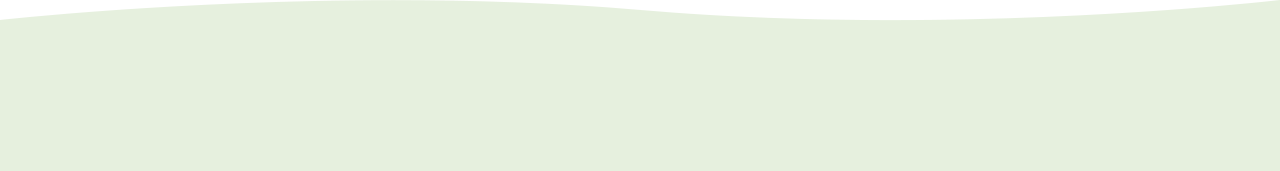
Alarme dans la bouche des enfants: les dents de craie
De plus en plus d’enfants souffrent de dents qui s’effritent. Jusqu’ici, la maladie est mal connue, mais le nombre de cas augmente.
Les dentistes et les caisses parlent d'une «nouvelle maladie du siècle»: jusqu'à 10 pour cent des écoliers suisses seraient touchés par les dents de craie; certaines sources mentionnent des taux encore plus élevés. La caisse d'assurance maladie allemande «Barmer Ersatzkasse» qui a fait réaliser des études sur ce sujet indique qu'en Allemagne, parmi les enfants de douze ans, un enfant sur trois présente déjà des dents de craie.
Autorin: Claudia Rawer
- Les dents de craie – qu’est-ce que c’est?
- Quand observe-t-on des dents de craie?
- Comment reconnaître la maladie?
- Depuis quand la MIH est-elle connue?
- Quelle est la cause des dents de craie?
- Aucune prévention possible si on ne connaît pas la cause
- Beaucoup de thèses, peu de preuves
- Le candidat le plus probable: les antibiotiques
- Que peuvent faire les parents?
- Agir le plus tôt possible
L'émail des dents de craie est beaucoup plus tendre que celui des dents saines. Normalement, l'émail dentaire est très dur et résistant. La couche extérieure de la couronne dentaire est composée de sels minéraux tels que le calcium et le phosphate ainsi que d'oligo-éléments tels que le magnésium et le fluorure. L'émail dentaire est la substance la plus dure formée par le corps humain et, en même temps, il est élastique. Cela nous permet de mâcher des aliments, même s'ils sont durs, et protège la dent dans son ensemble.
Sur les dents de craie, le développement de l'émail dentaire et sa composition sont altérés, les dents ne sont pas suffisamment minéralisées. Dans la plupart des cas, les dents touchées sont les dents permanentes qui se forment vers l'âge de six ans. Vers l'âge de douze ans, l'éruption des 28 dents permanentes est achevée.
Des dents de craie se forment si les molaires permanentes et les incisives sont mal minéralisées. C'est pourquoi on appelle cette maladie «hypominéralisation des molaires et des incisives», en abrégé MIH («hypo», un préfixe grec, signifie «sous, en dessous de», en langage médical également «insuffisance».) Les dents de lait sont beaucoup plus rarement atteintes d'hypominéralisation, mais cette fragilisation de l'émail dentaire peut également apparaître aussi tôt; on l'appelle alors hypominéralisation des molaires de lait ou MMH.
En général, les dents de craie sont visibles dès l'apparition des premières dents permanentes, bien que la maladie se développe déjà avant que la dent n'ait percé. En cas de déficience de la minéralisation, les dents de craie présentent fréquemment des taches blanc trouble ou des colorations jaunâtres et brunâtres.
La surface des dents est rugueuse et souvent poreuse, l'émail dentaire est tendre et parfois fragile. L'émail dentaire peut éclater rien que quand l'enfant mâche normalement.
Si un enfant se plaint de douleurs ressenties quand il mange ou qu'il se brosse les dents, c'est un signal d'alarme: la chaleur, le froid et la sollicitation mécanique lors du brossage déclenchent des douleurs au niveau des petites dents sensibles.
C'est en 1987 que les «dents de craie» ont été décrites scientifiquement pour la première fois. Seize ans plus tard, la maladie a reçu le nom compliqué d'hypominéralisation des molaires-incisives (MIH). Mais il est probable qu'elle existe depuis très longtemps déjà sans avoir été reconnue en tant que syndrome à part entière. Sans doute a-t-elle plutôt fréquemment été classée et traitée comme une carie (d'autant plus que les dents de craie sont effectivement plus sujettes aux caries). L'augmentation du nombre de diagnostics pourrait dont être lié, au moins en partie, au fait que la maladie est plus largement connue et à un niveau d'attention plus élevé des dentistes (pédiatriques). Mais cette hypothèse n'explique pas à elle seule l'augmentation du nombre de cas.

Le problème réside déjà dans la question. En effet, les causes de cette maladie dentaire ne sont pas connues.
Le développement des incisives et des molaires antérieures dès le huitième mois de grossesse, donc avant que les enfants ne viennent au monde, joue aussi un rôle. Il dure environ jusqu'à la fin de la quatrième année de vie. Mais la défaillance au niveau du développement n'est visible que des années plus tard.
Le trouble de la minéralisation de l'émail dentaire donne lieu à des études scientifiques depuis de plus de 30 ans. Toutefois, jusqu'ici, aucune cause manifeste n'a pu être décelée, on ne sait même pas quels sont les minéraux qui manquent dans l'émail.
Plusieurs candidats susceptibles d'être responsables de ce trouble du développement identifiés grâce à des observations et à des études (menées le plus souvent avec de petits nombres de cas) sont au centre des discussions.
En font partie:
- Des problèmes au moment de la naissance, notamment le manque d'oxygène. Cette supposition est fondée sur le fait que les cellules de l'organisme responsables de la formation de l'émail (améloblastes) sont extrêmement sensibles au manque d'oxygène.
- Les infections et autres maladies contractées pendant les trois premières années de vie. Des infections sévères, notamment et aussi des infections des voies respiratoires supérieures ainsi que l'asthme, pourraient être à l'origine des troubles de la formation de l'émail chez les nourrissons et les enfants en bas-âge.
- Les maladies organiques et la malnutrition: des maladies intestinales et rénales chroniques, mais aussi des diarrhées fréquentes ou la malnutrition et/ou des carences pourraient altérer le processus de minéralisation en cas de manque de phosphate de calcium qui doit être intégré dans l'émail dentaire.
- L'administration d'antibiotiques.
- L'influence de substances toxiques et nocives, par exemple de dioxines dans l'alimentation ou de bisphénol A qui est un plastifiant.
En raison du manque de connaissances, il n'existe pas de prévention pour la MIH et le traitement des enfants concernés est difficile. Pour compliquer les choses, les analyses de données, elles non plus, n'ont pratiquement pas fourni de résultats tangibles jusqu'ici. Le modèle de répartition dans les pays (analysé sur la base de documents fournis par les dentistes) est tellement diversifié qu'il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Par contre, il apparaît assez nettement que les enfants de toutes les couches de revenus sont touchés de la même manière.
Madame le professeur Katrin Bekes, qui travaille depuis 2015 à l'université de médecine de Vienne, dirige le département de pédodontie de la clinique dentaire universitaire de Vienne et a écrit un livre sur la MIH, part du principe qu'il n'y a pas qu'une seule cause à cette maladie. Il s'agirait plutôt de l'interaction de plusieurs facteurs. Elle plaide en faveur d'«études cliniques prospectives, de la grossesse à la sixième ou septième année de vie de l'enfant, qui permettraient de définir plus clairement les causes possibles du trouble de la minéralisation.»
Mais jusqu'ici, aucune des causes probables susmentionnées n'a pu être prouvée ou exclue de manière définitive. Roland Frankenberger, professeur de dentisterie conservatrice de la clinique universitaire de Giessen et de Marburg, s'est exprimé très ouvertement en 2018 dans la revue «Spektrum»: «S'obstiner à croire que l'un des facteurs évoqués dans ces discussions en est la cause reviendrait à lire dans le marc de café.»
De nombreux experts cherchent la cause dans la période qui a commencé environ en l'an 2000. Étant donné que l'on rencontre les dents de craie aujourd'hui bien plus souvent qu'auparavant, quelque chose a dû changer au cours de ces 20 années, ajoute-t-il.
Cela pourrait plaider en faveur de la «thèse du bisphénol A» étant donné que la substance plastifiante (BPA) est tellement omniprésente que l'on peut désormais la déceler dans le sang ou dans les urines de presque chaque être humain. Le bisphénol A est utilisé pour fabriquer le polycarbonate, un plastique, ainsi que les résines époxydes. Certes, ce perturbateur endocrinien est déjà interdit depuis 2011 (en Suisse depuis 2017) dans les biberons pour bébés, et depuis 2020 dans les papiers thermiques au sein de l'UE. Mais la substance continue d'être utilisée dans des bouteilles, des récipients et emballages alimentaires, pour le revêtement intérieur de canettes et boîtes de conserve, dans les CD et DVD, les dispositifs médicaux, les jouets et les smartphones. Toutefois, l'augmentation parallèle de l'exposition au BPA et de la fréquence de la MIH pourrait relever du hasard. En tout état de cause, il n'existe jusqu'ici aucune preuve scientifique. Et, bien sûr, d'autres substances dont l'utilisation a augmenté au cours des dernières décennies sont également envisageables comme cause de la MIH.
Dans sa pratique quotidienne de la médecine dentaire, le professeur Katrin Bekes constate que «la MIH est plus fréquente chez des enfants qui ont été atteints de maladies infectieuses et/ou auxquels on a administré des antibiotiques au cours des phases critiques de la formation de l'émail». En bref, l'une des plus grandes et plus récentes études (2021) a permis d'arriver au résultat central suivant: «Il existe un lien identifiable entre la prescription d'antibiotiques et l'apparition de la MIH.»
Certes, tous les enfants auxquels un antibiotique a été prescrit pendant cette période critique ne présentent pas de dents de craie. Mais on constate un lien pertinent, notamment une plus grande fréquence de MIH chez les enfants qui, en raison de maladies des voies respiratoires, ont été traités avec des antibiotiques, ainsi que chez les enfants qui ont reçu des antibiotiques combinés rarement prescrits contre les infections urinaires. Mais un lien ne constitue toujours pas une preuve de la cause, si bien qu'ici aussi, des études cliniques sont réclamées de toute urgence.

En tout cas, ce qui est déjà entré dans les mœurs en Suisse: habituer leurs enfants dès leur plus jeune âge à une hygiène buccale et dentaire consciencieuse. Les enfants suisses sont les champions du monde du brossage de dents, et les caries dentaires n'ont nulle part été autant repoussées qu'ici. Mais, même dans le pays modèle du brossage de dents, le sucre et les acides (contenus par exemple dans les jus de fruits ou les boissons à la mode telles que «Red Bull» ou «Ice Tea») attaquent l'émail dentaire sensible. En aucun cas, on ne doit habituer les enfants à boire des jus de fruits dans un biberon. Et le brossage correct des dents – avec des brosses appropriées et pas trop fort – ainsi que le soin des gencives doivent faire l'objet d'un apprentissage.
Pour les dents de craie, comme nous l'avons dit plus haut, il n'existe pas de prévention, mais l'hygiène dentaire correcte est indispensable, surtout en présence de ce trouble: l'émail dentaire poreux est beaucoup plus sensible aux caries que celui de dents qui se développent normalement. Les enfants qui ont des douleurs quand ils se brossent les dents – ce qui est très fréquent en cas de MIH – tentent bien souvent de se soustraire à cette procédure. C'est pourquoi le contrôle – par les parents ou le dentiste pédiatrique – est très important.
Les visites chez le dentiste sont onéreuses – malgré cela, les spécialistes conseillent de faire vérifier les molaires de lait à l'âge de deux à trois ans. Dans tous les cas, il est recommandé de faire procéder, dès le début de l'éruption des dents permanentes, donc environ entre cinq et six ans, à un contrôle professionnel visant à détecter les taches typiques blanchâtres ou jaunâtres et brunâtres sur les surfaces de mastication et sur le côté des dents.
Plus tôt des signes de MIH (voire une hypominéralisation des molaires de lait MMH) sont constatés, plus tôt il sera possible de limiter les dommages sur les dents. L'enfant a plus de chances d'éviter des douleurs et des dommages sévères pendant sa vie d'adulte. Si la dent n'est pas encore gravement endommagée, il est possible, dans des cas de moindre gravité, de la vitrifier, par exemple en appliquant une couche de résine. Dans des cas graves, des obturations dentaires ou des couronnes peuvent stabiliser la dent et restaurer sa fonction. Il est recommandé aux parents et aux enfants concernés de demander des conseils individuels à un expert.