A.Vogel recherche
Lorsque la recherche interne est activée, des données personnelles telles que votre adresse IP sont transmises à notre moteur de recherche Cludo. Les données sont ainsi transférées vers un pays tiers. Veuillez cliquer ici si vous souhaitez afficher la recherche interne. Vous trouverez plus d'informations sur la protection des données ici : Protection des données.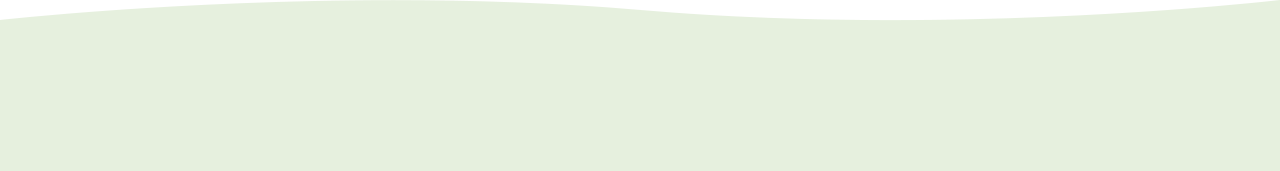
Neuroplasticité : le cerveau avide d'apprendre
La forme mentale n'est pas nécessairement une question d'âge. Nouvelles découvertes sur la neuroplasticité tout au long de la vie.
Texte : Gisela Dürselen
- 80 milliards de neurones
- Processus de dégradation naturels
- Ce qui est nécessaire perdure
- Une activité tout au long de la vie crée des réserves
- Vieillir avec un cerveau en bonne santé
- Prendre soin de son corps et de son esprit
- Pourquoi l'oubli est également important
- Avantage du cerveau par rapport à l'IA : la créativité
Le cerveau humain contrôle tous les processus du corps et façonne les émotions, la morale et la personnalité. Pour cela, il a besoin d'au moins 80 milliards de neurones, dont chacun est relié à environ 10 000 autres neurones par des connexions appelées synapses. Environ 17 à 18 milliards de ces cellules nerveuses se trouvent dans le cortex cérébral, la région du cerveau la plus récente et la plus développée sur le plan évolutif, qui est notamment responsable de la pensée complexe. Aucun animal ne possède un nombre comparable de neurones dans cette partie importante du cerveau.
Pour accomplir ses tâches, le cerveau consomme jusqu'à un quart de l'énergie absorbée quotidiennement, explique le neuroscientifique et psychologue Lutz Jäncke, professeur à l'Institut de psychologie de l'Université de Zurich. Cela se produit également au repos, car le cerveau fonctionne toujours en arrière-plan. Il traite et interprète les expériences vécues et crée ainsi un modèle du monde dans le subconscient. « La façon dont nous percevons et évaluons le monde dépend donc essentiellement de notre parcours biographique et, par conséquent, de notre contexte culturel », explique le professeur Jäncke. C'est également l'une des raisons pour lesquelles les contacts entre différentes cultures donnent si souvent lieu à des malentendus.
La mauvaise nouvelle, c'est que le processus naturel de vieillissement n'épargne pas le cerveau. Les processus de dégradation commencent vers l'âge de 65 ans. Les neurones et le volume physique du cerveau diminuent, les régions cérébrales ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'à l'adolescence. Selon le professeur Jäncke, l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage, est particulièrement touché par cette dégradation.

Pour garder un cerveau jeune : des loisirs tels que les échecs ou des activités sportives en plein air, par exemple le paddle.
Mais il y a aussi une bonne nouvelle : la dégradation est lente, environ 0,5 % du volume par an, et elle varie considérablement d'un individu à l'autre. Dans le cadre du projet « Dynamique du vieillissement en bonne santé », le professeur Jäncke et son équipe ont observé depuis 2011, dans le cadre d'une étude à long terme menée auprès de seniors suisses, que chez environ 5 à 10 % des participants, l'hippocampe s'était même agrandi avec le temps au lieu de rétrécir comme chez les autres. Ces personnes étaient les plus actives à tous égards et elles étaient également les moins sujettes aux maladies neurologiques telles que la démence. Comme l'a révélé l'étude, les activités physiques et sociales ont un effet protecteur particulier sur le cortex, qui est déjà affecté à un stade précoce de la maladie d'Alzheimer.
« L'état de notre cerveau dépend donc de ce que nous faisons », explique le professeur Jäncke. En effet, seul ce qui est utilisé est conservé dans le cerveau : les activités répétitives renforcent certaines connexions entre les neurones ; les synapses inutilisées diminuent et disparaissent complètement si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Étant donné que les informations stockées dans le cerveau dépendent de la force des connexions du réseau, la répétition est un élément central de l'apprentissage et de la mémoire : « Tout ce que nous pratiquons intensivement modifie notre cerveau. »
Dans le cadre de l'étude américaine sur la démence menée auprès de religieuses, qui se poursuit encore aujourd'hui, les capacités intellectuelles de religieuses âgées ont été comparées aux résultats d'examens post mortem de leur cerveau : les résultats pathologiques ont révélé à plusieurs reprises des signes typiques de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, ces participantes étaient en excellente forme mentale de leur vivant. « Pourquoi peut-on mesurer une dégénérescence cérébrale alors qu'aucun déficit mental n'est détectable ? », s'interroge le professeur Jäncke.
La question cruciale est la suivante : « Que font le reste du cerveau et les neurones qui ne sont pas morts ? » La conclusion logique est la suivante : « Une dégénérescence anatomique n'est pas nécessairement un indicateur de déclin des capacités cognitives. D'autres zones du cerveau intactes peuvent fonctionner plus efficacement et ainsi compenser les défauts anatomiques. Les personnes qui ont mené une vie active, y compris sur le plan mental, disposent d'une réserve cognitive et souvent anatomique qui est capable de compenser les processus de dégradation liés à l'âge. »

Le fait qu'une personne reste mentalement alerte jusqu'à un âge avancé ne dépend donc pas tant de la substance cérébrale restante que de sa fonctionnalité – et celle-ci peut être au moins partiellement restaurée, même après des lésions graves, telles qu'un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânio-cérébral suite à un accident. Selon plusieurs études, même dans de tels cas, le cerveau est capable de créer de nouvelles connexions et de se restructurer afin de compenser les troubles existants.
Pour vieillir avec un cerveau en bonne santé, le professeur Jäncke recommande cinq mesures essentielles : « une bonne condition physique, mentale et sociale, ainsi que la prévention du diabète et de l'hypertension artérielle ».
Apprendre à jouer d'un instrument de musique ou la langue de son pays de vacances préféré, danser ou pratiquer un nouveau sport sont des activités qu'il est plus judicieux d'intégrer dans la vie quotidienne que, par exemple, mémoriser des séries de chiffres ou résoudre des problèmes mathématiques pour faire travailler son cerveau. La danse dans un contexte social, par exemple, sollicite le cerveau de manière multidimensionnelle, tandis que le mouvement améliore l'apport en oxygène et la circulation sanguine.
Un apport optimal en oxygène et en sang est important pour que le cerveau puisse remplir ses fonctions. La démence vasculaire, causée par un trouble de la circulation sanguine dans le cerveau et deuxième forme de démence la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, peut être provoquée entre autres par le surpoids, l'hypertension artérielle et le diabète. L'hypertension artérielle et le diabète ont tous deux un impact négatif sur le métabolisme, ce qui peut entraîner un rétrécissement des vaisseaux sanguins et, comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer, des dépôts dans le cerveau. Selon plusieurs études, l'hyperglycémie et l'hypertension artérielle sont favorisées par le stress chronique.
Selon le professeur Jäncke, l'essentiel est de ne pas attendre la vieillesse, mais de combiner dès le plus jeune âge le corps et l'esprit ainsi que l'envie et la joie de vivre avec une certaine mesure de contrôle des stimuli. Cela vaut également pour certaines recommandations alimentaires visant à entretenir la forme du cerveau. Les personnes qui mènent une vie disciplinée font de toute façon suffisamment d'exercice et évitent le surpoids ; il reste en bonne santé grâce à une alimentation variée et peut ainsi profiter pleinement de la vie sans régime ni ascèse. Une telle personne ne passe pas non plus ses soirées à somnoler devant la télévision, ennuyant ainsi son cerveau, ni à surfer toute la journée sur les réseaux sociaux, le surchargeant de stimuli trop nombreux et pour la plupart inutiles.
Apprendre une langue de manière ludique est encore possible à un âge avancé, mais ce n'est pas aussi facile que dans la petite enfance. En effet, au cours d'une vie, il existe des phases dites sensibles, c'est-à-dire des périodes propices à une neuroplasticité accrue, pendant lesquelles certaines choses s'apprennent particulièrement facilement. À aucun autre moment de la vie, la neuroplasticité du cerveau n'est aussi prononcée que dans la petite enfance. Ainsi, à la naissance, les nouveau-nés disposent de beaucoup plus de connexions neuronales qu'ils n'en ont réellement besoin. Ce qui est nécessaire se renforce au cours du développement, le reste disparaît.

Se remémorer le passé en toute sérénité, même si cela implique des trous de mémoire ? Pas de problème : selon les chercheurs, dans la mémoire à long terme, l'oubli est tout aussi important que la mémorisation.
Le fait que les réseaux se résorbent, que des neurones disparaissent et que des contenus soient effacés n'est donc pas seulement un phénomène lié au vieillissement, mais se produit à chaque étape de la vie – et est souvent important. En effet, au cours de son évolution, le cerveau s'est adapté, dans le cadre d'une stratégie de survie, de manière à ce que sa structure et ses fonctions soient parfaitement adaptées à la situation de vie actuelle et puissent réagir de manière optimale. Cela inclut également la suppression des éléments superflus.
Une étude américaine publiée en 2023 dans « Molecular Psychiatry » souligne que le rétrécissement ne doit pas être considéré comme une déficience. Pour le meilleur ou pour le pire, les changements « descendants » dans le cerveau, c'est-à-dire l'affaiblissement ou la disparition de certaines synapses, font partie du programme de neuroplasticité et ne constituent pas un défaut de celui-ci. La neuroplasticité du cerveau doit donc être comprise conceptuellement comme un équilibre entre les deux directions, grâce auquel le cerveau peut s'adapter de manière flexible à certaines exigences. Les deux parties se complètent mutuellement et permettent au cerveau de remodeler ses connexions par un réglage fin neuronal afin d'optimiser l'efficacité du réseau pour certaines conditions.
Dans la mémoire à long terme, le professeur Jäncke considère même que l'oubli est presque plus important que la mémorisation, car seuls les éléments pertinents sont conservés. L'oubli est particulièrement essentiel dans le cas d'« informations mémorielles négatives profondément ancrées », par exemple dans le cas de divers troubles anxieux et troubles de stress post-traumatique, mais aussi dans le cas de mauvaises habitudes qui ne disparaissent pas simplement, mais doivent être désapprises activement à l'aide de certaines stratégies ou d'une thérapie. En effet, ces schémas sont souvent associés à des émotions fortes ou, comme dans le cas des mauvaises habitudes, solidement ancrés dans la structure cérébrale à force de répétitions, et occupent donc une place prépondérante dans la hiérarchie du réseau d'informations.
En 2023, le « Human Brain Project », une coopération internationale dédiée à une meilleure compréhension du cerveau humain, a pris fin. Ce projet, qui a duré dix ans, avait pour objectif de représenter le cerveau, avec ses milliards de neurones et ses billions de synapses, dans une simulation informatique. L'étude a fourni de nombreuses informations importantes, notamment sur les fonctions cognitives et l'anatomie du cerveau, mais l'objectif initial, à savoir la simulation, n'a pas été atteint : selon le professeur Jäncke, la complexité du cerveau n'est toujours pas entièrement comprise. On ignore par exemple comment les neurones peuvent générer la conscience.
Dans un projet ultérieur, le professeur Jäncke suppose que d'autres voies seront explorées : l'intelligence artificielle (IA) est désormais le moteur de la recherche ; c'est pourquoi on va essayer de développer des systèmes techniques qui fonctionnent autant que possible comme un cerveau humain. Les deux possèdent des propriétés et des capacités cognitives fondamentalement différentes, et les deux ont des forces et des faiblesses.
Les systèmes d'IA sont plus performants dans des domaines tels que l'analyse de données, la mémorisation et les statistiques, mais les perturbations lors de l'apprentissage entraînent la suppression des connaissances déjà acquises. Les cerveaux humains sont plus créatifs et plus enclins à l'expérimentation, et surtout, ils consomment beaucoup moins d'énergie que l'IA. Si les systèmes d'IA fonctionnaient de manière plus similaire aux cerveaux humains, ils seraient beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique.
PUBLICITÉ



