A.Vogel recherche
Lorsque la recherche interne est activée, des données personnelles telles que votre adresse IP sont transmises à notre moteur de recherche Cludo. Les données sont ainsi transférées vers un pays tiers. Veuillez cliquer ici si vous souhaitez afficher la recherche interne. Vous trouverez plus d'informations sur la protection des données ici : Protection des données.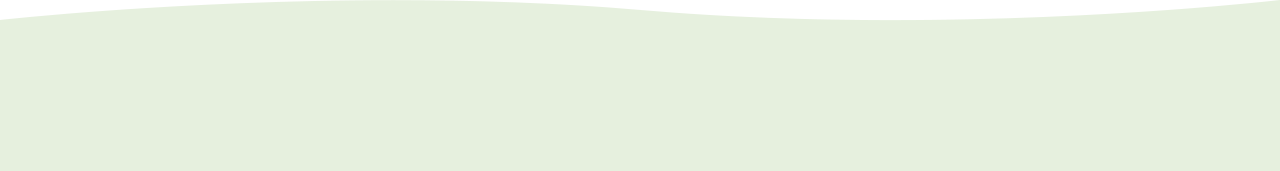
Les maladies les plus fréquentes en été – quelles mesures préventives peut-on prendre ?
Les plus belles semaines de l’année ne devraient pas être gâchées par des problèmes d’estomac, une inflammation de la vessie, un coup de soleil ou autres indispositions. Avec un peu de prudence et quelques précautions, la plupart des maladies contractées pendant un voyage ou en vacances peuvent être évitées.
Une grande partie des Suisses passent leurs vacances dans d'autres pays européens, tandis que 15 % restent dans leur propre pays. Plus de 90 % des personnes interrogées prévoyaient de partir au moins une fois en vacances en 2024. Environ la moitié d'entre elles prévoyaient même de faire au moins trois voyages cette année-là. Selon le rapport sur les vacances d'une grande agence de voyage suisse, beaucoup ne font toutefois aucun préparatif pour leur voyage. Or, même des maladies banales peuvent gâcher les vacances.
- Pansements (pansements pour ampoules et pansements imperméables)
- Matériel de pansement, sparadrap
- Spray désinfectant pour les plaies
- Pince à épiler et ciseaux
- Gants jetables
- Crème solaire en quantité suffisante et pommade apaisante contre les coups de soleil
- Produit anti-insectes et gel anti-démangeaisons
- Analgésiques
- Thermomètre médical
- Pommade contre les brûlures et pour la cicatrisation des plaies
- Médicaments contre la diarrhée
- Médicaments contre les maux de gorge, la toux et le rhume (spray nasal)
- Collyre (contre les yeux douloureux dus aux courants d'air, à la lumière ou à la poussière)
- Si nécessaire : médicaments contre le mal des transports
Les journées à la plage ou dans les montagnes sont comptées et nombreux sont ceux qui aimeraient rentrer à la maison « en bonne santé » avec un beau bronzage. Ils utilisent donc moins de crème solaire ou un facteur de protection insuffisant et ils restent au soleil à l’heure du déjeuner – sans être conscients des dommages à long terme qu’ils encourent.
Que faire ?
On peut trouver des moyens d’apaiser une peau brûlante et rougie dans la cuisine comme dans la nature. On peut notamment appliquer sur les parties concernées des compresses tièdes imbibées de thé noir, de thé fort à base de fleurs de soucis ou de jus de concombre. Si la peau est trop sensible, il est possible d’utiliser un vaporisateur à la place de compresses. Le yaourt frais, le fromage blanc ou le babeurre ont également une action bénéfique. Les personnes en vacances dans un pays méditerranéen et ayant de l’aloe vera à portée de main peuvent aussi s'en servir sur les zones brûlées. En revanche, les crèmes grasses et la sauge doivent être évitées. Dans les cas graves, en particulier en cas de cloques ou de frissons, il est conseillé de consulter un médecin.
Mesures préventives ?
Il est important d’avoir une bonne crème solaire avec un indice de protection élevé et de l’appliquer aussi souvent et autant que nécessaire. Les premiers jours à la plage, il convient de prendre le soleil sous un parasol ; à la piscine, on peut se mettre sous un arbre. Par ailleurs, il est recommandé de couvrir les parties du corps encore pâles avec des vêtements légers et aérés lorsqu’on fait du vélo ou en randonnée, et de mettre un t-shirt aux plus jeunes enfants même lorsqu’ils sont dans l’eau.
Les infections bactériennes ou virales qui endommagent la muqueuse intestinale réduisent la capacité de l'intestin à absorber les nutriments. Pour y remédier, le corps libère davantage d'eau dans l'intestin, ce qui provoque des selles liquides. Cette forme de diarrhée est également appelée diarrhée du voyageur.
Que faire ?
Les médicaments à base de plantes contenant des tanins ont un effet apaisant et astringent sur la muqueuse intestinale. Cela permet de « sceller » la muqueuse intestinale, de sorte que moins d'eau peut être libérée dans l'intestin. Si la diarrhée persiste pendant plus de 3 jours, s'accompagne de fièvre ou si vous soupçonnez la présence de sang dans les selles, consultez impérativement un médecin. L+ L'acide lactique, les probiotiques ou les préparations à base de levure contribuent à normaliser la flore intestinale.
Conseil : soupe de carottes
Grâce à sa teneur élevée en pectine et en huiles essentielles, la soupe de carottes aide à soulager les troubles digestifs tels que la diarrhée. La cuisson prolongée des carottes – et uniquement dans ce cas ! – permet la formation d'acides oligogalacturoniques (oligogalacturonides). Ces molécules de sucre ressemblent tellement aux structures superficielles de la paroi intestinale que les bactéries responsables de la diarrhée manquent leur cible initiale.
Recette de la soupe de carottes de Moro :
Faites cuire 500 g de carottes pelées (bio) dans un litre d'eau pendant une heure, puis passez-les au tamis ou mixez-les, rajoutez de l'eau bouillie pour obtenir à nouveau un litre et ajoutez trois grammes de sel de cuisine.
Comment prévenir ?
Pour prévenir la diarrhée du voyageur, le principe suivant s'applique : « Cook it, peel it, or forget it » (cuisez-le, épluchez-le ou oubliez-le). Cela signifie que dans les pays à risque, seuls les aliments cuits ou les fruits et légumes épluchés doivent être consommés. L'eau contaminée reste également la principale source d'infection.
Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les aliments suivants :
- viande ou poisson crus
- fruits non pelés
- salade, crème glacée
- buffet froid
- eau du robinet
- glaçons dans les boissons

Il est souvent impossible d’identifier la cause de cette indigestion. Le fruit a-t-il été mal lavé ? La salade de poisson a-t-elle été mal digérée ? Ou est-ce peut-être le poulet au piment et à l'ail qui n'était plus très frais ? Peut-être qu’on a retiré les glaçons du verre trop tard ?
En général, on le remarque quelque temps après le repas – l’estomac commence à grogner, puis arrivent de douloureuses crampes et enfin, une diarrhée rapide et/ou des vomissements.
En cas de fortes températures, les germes se multiplient rapidement et plus leur nombre est élevé, plus l’action du système immunitaire sera vaine. C'est pourquoi les vacanciers séjournant dans des pays chauds sont particulièrement sujets à la gastro-entérite. Par ailleurs, les enfants et les personnes d’un certain âge sont plus souvent touchés car leur système immunitaire n’est pas encore parfaitement constitué ou est affaibli.
Que faire ?
La diarrhée et les vomissements sont les premiers signes de défense de l'organisme. Il ne faut donc pas les étouffer avec des médicaments. En effet, le corps peut se débarrasser lui-même de la plupart des infections gastro-intestinales en l’espace d’un à trois jours. Ne rien manger le premier jour (l’appétit fait de toute façon souvent défaut), puis se contenter de biscottes, de purée de pommes de terre, de crème d’avoine ou de bouillon de légumes sans graisse peut être suffisant. Une bouillotte calme les crampes d’estomac. Si l’on doit manger aussi peu que possible, on peut en revanche boire autant qu’on le souhaite pour expulser les virus et bactéries à fond de train. Le thé au fenouil, à la camomille, au carvi ou au gingembre associé à de l’eau minérale plate – ou à des boissons électrolytes pour les personnes très affaiblies – peut encourager la guérison.
Mesures préventives ?
La seule mesure de prévention est d’adopter une hygiène stricte lors de la préparation des aliments, un point sur lequel on n'a souvent aucune influence en vacances. Il est dans tous les cas indispensable de se laver les mains fréquemment.
Un maillot de bain mouillé porté trop longtemps, des toilettes sales, se baigner dans une eau infestée de germes, des vêtements trop légers le soir, des rapports sexuels – et les douleurs brûlantes au sortir de l’eau, ainsi que l’augmentation du besoin d’uriner et les crampes sont là. Les infections aiguës de la vessie chez la femme sont – bien que gênantes – sans complications dans plus de 90 % des cas. Les enfants, femmes enceintes et hommes concernés doivent constamment suivre un traitement médical.
Que faire ?
En cas d’inflammation de la vessie, une bouillotte sur le ventre et des chaussettes chaudes agissent efficacement contre les crampes. En outre, il est conseillé de boire beaucoup : deux litres d’eau par jour et un thé pour la vessie ou les reins aident à rincer les voies urinaires. Les feuilles de busserole, de bouleau et d’ortie, ainsi que les gerbes d’or, la canneberge (cranberry) et la prêle sont utilisées le plus fréquemment sous forme de thé ou d’extrait.
Si les symptômes ne s’améliorent pas après plusieurs jours ou si la fièvre apparaît, on ne peut qu’envisager une consultation chez le médecin. Il ne faut en aucun cas prendre à la légère une inflammation prolongée de la vessie, celle-ci pouvant se développer en une inflammation du bassinet du rein.
Mesures préventives ?
Mettre des vêtements secs au sortir de l’eau. Après le rapport sexuel, vider la vessie pour rejeter d’éventuels germes. Par ailleurs, un jus de cranberry (200 ml/jour) est tout à fait indiqué comme mesure préventive. Les fruits contiennent en effet des substances anti-bactériennes naturelles qui empêchent les bactéries de se loger dans la vessie. Les huiles de moutarde de la capucine, lesquelles sont d’ailleurs excellentes en salade, présentent également un effet similaire.
Nager, sauter, glisser, plonger – voilà à quoi peuvent ressembler des vacances plaisantes dans l’eau pour les grands et les petits. Cependant, même si avoir de l’eau dans les oreilles n’est pas préjudiciable, une activité prolongée dans l’eau peut ramollir le cérumen et la peau dans le conduit auditif à tel point que les fonctions de protection disparaissent. Cela facilite l’intrusion de bactéries et champignons présents dans l’eau et responsables de l’inflammation. En outre, une forte concentration de chlore dans l'eau peut endommager les cellules du conduit auditif. Résultat : des démangeaisons et l’impression d’avoir l’oreille bouchée. Cette inflammation, appelée « otite du baigneur », est une infection estivale typique du conduit auditif externe et peut être très douloureuse. Toutefois, contrairement à l’otite moyenne, elle n’est que rarement accompagnée de fièvre.
Que faire ?
Renoncer à la baignade pour maintenir le conduit auditif au sec. Pour le traitement, il convient de consulter un médecin.
Mesures préventives ?
Rincer les oreilles avec de l’eau douce et propre après la baignade, puis bien secouer les conduits auditifs ou les sécher au sèche-cheveux. Protéger les oreilles avec des tampons auriculaires (bouchons semblables à de la ouate avec un noyau de cire). En revanche, les plongeurs ne doivent pas porter de bouchons dans les oreilles pour ne pas gêner la compensation de la pression.

Le visage rouge et brûlant, la peau froide, des maux de tête, des vertiges, des agitations, la nausée au point de vomir et parfois de la fièvre ? Cela ressemble fortement à une insolation. Lorsque la tête et la nuque sont exposées au soleil tapant un certain temps sans protection, les méninges ont une réaction agacée. Les jeunes enfants et les personnes ayant une calvitie ou un crâne dégarni sont particulièrement touchés. Bien souvent, les symptômes ne se remarquent que plus tard. En effet, après une journée de canicule passée en plein air, les douleurs peuvent survenir le soir seulement.
Que faire ?
Les personnes victimes d’une insolation doivent se rendre dans un lieu frais sans attendre et s’allonger avec la tête légèrement surélevée. Il faut aussi refroidir la tête et la nuque avec des serviettes froides. Par contre, il ne faut jamais appliquer une poche de glace directement sur la tête ! Absorbez des liquides froids, éventuellement tièdes, comme du thé sucré, un bouillon ou un mélange d'eau, d'un peu de jus de fruit et d'une pincée de sel (pour compenser les pertes de sel).
Mesures préventives ?
Il est conseillé de porter un couvre-chef fait d'un matériau respirant et de boire beaucoup d'eau. Le sport et les activités physiques éprouvantes en plein soleil de midi doivent être évitées dans tous les cas.
En été, pendant les jours de canicule, même une petite insuffisance veineuse se fait sentir par des gonflements, des douleurs et de la fatigue dans les jambes.
Que faire ?
Ne restez pas assis au soleil sans bouger de manière prolongée. Levez les jambes dès que vous le pouvez. Quelques jets d’eau agissent immédiatement. Accordez à vos jambes et à vos pieds autant d’eau fraîche que possible : dans la mer, dans un lac, sous la douche, dans un ruisseau ou dans une fontaine pendant votre randonnée. Cela vous soulagera rapidement. Un gel rafraîchissant pour les veines apaise aussi les douleurs et la sensation de jambes lourdes. Le soir, un bain de pieds tiède avec du sel de mer, une infusion de romarin, quelques gouttes d’huile d‘eucalyptus, de menthe poivrée ou de citron détend les jambes et pieds très lourds.
Mesures préventives ?
Bouger est indispensable pour prévenir les jambes lourdes ; le nordic walking (marche nordique), le jogging, la natation, le cyclisme, le tennis de table et la danse sont ici particulièrement recommandés. De même, marchez plus souvent pieds nus sur une plage de sable ou de graviers, sur une prairie ou sur des installations spéciales. En voiture ou en avion, quelques exercices pour les pieds se révèlent apaisants.
Une insuffisance veineuse doit être traitée de manière régulière et continue avec des préparations à base d'extrait de marron d'Inde. Le principe actif qu’il contient, l’aescine, raffermit et colmate la paroi veineuse, empêchant ainsi l’intrusion de liquide dans le tissu (œdème).
Le jet lag est un dérèglement du biorythme causé par les vols long-courriers, qui se manifeste principalement par de la fatigue et des troubles du sommeil, car le rythme naturel du corps ne correspond pas à l'environnement extérieur de la destination. On compte au maximum un jour par heure de décalage horaire pour s'adapter. Pour un vol de 7 heures, le corps peut donc avoir besoin d'une semaine, mais ce délai varie fortement d'une personne à l'autre.
Que faire ?
Pour les longs voyages en avion, il est possible de s'adapter au rythme horaire de la destination avant le départ. Pour les vols vers l'est, couchez-vous progressivement plus tôt, pour les vols vers l'ouest, couchez-vous plus tard que d'habitude. Si vous ne voyagez que pour une courte durée, essayez de conserver votre rythme habituel. Pendant le vol, buvez beaucoup d'eau et bougez beaucoup. Essayez de vous adapter à l'heure de votre destination, c'est-à-dire dormez lorsqu'il fait nuit à votre destination. Évitez de consommer trop de caféine et d'alcool, car ces deux substances peuvent aggraver le décalage horaire. Après votre arrivée, vivez selon l'heure locale de votre destination. Ne dormez pas pendant la journée, mais essayez de rester éveillé (vers l'ouest) ou de vous coucher plus tôt (vers l'est).
Comment prévenir le décalage horaire ?
Même avec une préparation optimale, il est impossible d'éviter complètement le décalage horaire. On peut seulement en réduire les effets.

Les chercheurs sont toujours sans réponse au sujet des causes exactes des maladies des voyages comme le mal de mer. Les remous en bateau, les virages en voiture ou les turbulences en avion sont un véritable défi pour le système homéostatique des enfants et des adultes.
En général, les bébés ne souffrent pas de ces maladies. Cependant, entre deux et douze ans, de nombreux enfants supportent mal les voyages, au point de devoir vomir.
Que faire ?
Selon les besoins, il est possible de prendre pendant le voyage ou deux heures avant le départ 5 granules du remède homéopathique Cocculus D4 contre l’envie de vomir et les vertiges.
De même, la racine de gingembre est souvent efficace contre la nausée et l’envie de vomir. On peut ainsi mâcher de fines tranches de gingembre frais pendant le voyage. Cela est certes trop fort pour les enfants mais par chance, le gingembre est aussi disponible sous forme de gélules, de comprimés à sucer et de gouttes. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d’hypertension ou de calculs biliaires ne doivent pas prendre de préparations à base de gingembre.
Si ces mesures sont inefficaces, des médicaments en vente libre sont disponibles en pharmacie. La plupart contiennent du dimenhydrinate et se trouvent sous forme de chewing-gum, de comprimés, de gélules, de sirop ou de suppositoire. L'effet s'installe 30 à 60 minutes après la prise du médicament et dure trois à six heures. Vous devez absolument vous renseigner sur les contre-indications, la posologie et les effets secondaires (fatigue).
Mesures préventives ?
Il est conseillé aux personnes souffrant de maladies des voyages de ne pas trop manger et de prendre un repas léger avant le départ. Des biscottes, des sticks salés et des fruits pour un repas devraient suffire. Pensez à boire en route : du thé au gingembre ou de l’eau plate, voire du coca en cas de maux d’estomac.
Il convient également de regarder à l’extérieur pendant le trajet (dans l’idéal, dans le sens de la marche) et de ne pas lire ou jouer à des jeux qui dirigent le regard vers le bas. Enfin, lors d’un voyage en voiture, de l’air frais et des pauses régulières garantissent un certain bien-être aux passagers.
Quels remèdes ?
Il existe peu de remèdes maison contre les maux de dents. On peut citer notamment le clou de girofle (mâché) contre les douleurs aiguës. Il agit comme un léger anesthésiant. Mais cela ne permet que de patienter jusqu'à la consultation chez le dentiste. En cas d'inflammation des gencives, le rinçage à la tisane de camomille a fait ses preuves. Tamponner les zones concernées avec une solution à base de camomille disponible en pharmacie apporte également un soulagement.
Comment prévenir ?
Les maux de dents et les problèmes de gencives peuvent être évités grâce à une bonne hygiène bucco-dentaire et à des visites régulières chez le dentiste. Arrêter de fumer et avoir une alimentation saine sont également des mesures préventives efficaces.

Il est difficile de croire à quel point les maux de gorge sont fréquents en été. La voiture est garée au soleil, les sièges et le volant sont brûlants – on met alors la climatisation à une température trop basse et de l’air frais souffle bientôt sur le visage ; dans les restaurants ou dans les supermarchés climatisés, le chaleur du corps laisse rapidement place aux frissons ; on répond à la soif par une boisson bien glacée ; en randonnée, on peut être surpris par la bruine et les vêtements imperméables ne tiennent plus vraiment au chaud – autant d’exemples qui peuvent amener des sensations de grattement dans la gorge, lesquels se transforment bien vite en maux de gorge.
Que faire ?
Boire beaucoup (et se gargariser) pour humidifier les muqueuses, et ainsi les renforcer : par exemple un bon thé à la camomille, au thym ou à la sauge ou un jus de citron frais dilué dans de l’eau (chaude) avec un peu de miel pour le sucre. Prendre des comprimés à sucer avec des herbes adéquates, comme HalsWohl ou Santasapina d’A.Vogel. De même, une compresse d’eau (salée) et de fromage blanc enroulée autour du cou apaise l’inflammation et les douleurs.
Mesures préventives ?
Régler la climatisation dans la voiture et à l’hôtel de sorte que la température ne soit pas inférieure à 6 °C en dessous de la température extérieure. En cas de températures élevées, ayez toujours avec vous une écharpe en coton et une veste légère lorsque vous vous trouvez dans une pièce climatisée. Vous pouvez également renforcer de manière ciblée vos défenses immunitaires en prenant une préparation à base d’échinacée.
Vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours celui ou celle qui se fait piquer par les moustiques ? Il y a principalement deux raisons à cela : le dioxyde de carbone et l'odeur corporelle.
Les moustiques locaux, particulièrement actifs le soir, sont attirés par le gaz présent dans l'air expiré, qu'ils peuvent détecter jusqu'à une distance de 50 mètres. Les moustiques diurnes, comme le moustique tigre asiatique, sont quant à eux davantage attirés par les odeurs corporelles, qui proviennent de la composition des bactéries cutanées et des produits métaboliques tels que l'acide lactique, l'acide urique et l'ammoniac.
La composition de ces derniers dépend à son tour des gènes et du métabolisme actuel et varie donc considérablement d'une personne à l'autre. Mais le groupe sanguin est également déterminant, car il est perceptible par la peau chez 85 % des personnes. Selon des scientifiques japonais, les sujets du groupe sanguin 0 ont été piqués deux fois plus souvent que ceux du groupe sanguin A. Le groupe sanguin B se situait entre 0 et A.
Qu'est-ce qui aide ?
- Les arômes essentiels de l'huile de citronnelle, de lavande ou de géranium repoussent les insectes. Cependant, ils ont une odeur forte et leur effet est souvent de courte durée. Si le moustique a quand même piqué, il est utile d'appliquer des glaçons ou du vinaigre, une tranche d'ail ou de l'huile d'arbre à thé.
- Le répulsif naturel le plus efficace à ce jour est le citriodiol (PMD), un extrait des feuilles d'eucalyptus citronné, contenu par exemple dans Zedan SP ou Antibrumm Naturel (Ökotest 4/2017).
- Vous trouverez d'autres astuces pour utiliser facilement les plantes médicinales dans la pharmacie d'extérieur A.Vogel.
- Alfred Vogel accrochait dans sa chambre une branche d'eucalyptus, parfois même un bouquet de jeunes branches d'eucalyptus, lorsqu'il se rendait dans des pays subtropicaux ou tropicaux. Cela lui permettait non seulement de lutter contre les moustiques, mais aussi de purifier l'air, facilitant ainsi la respiration, en particulier lorsque l'air était lourd, étouffant et moisi.
PUBLICITÉ




